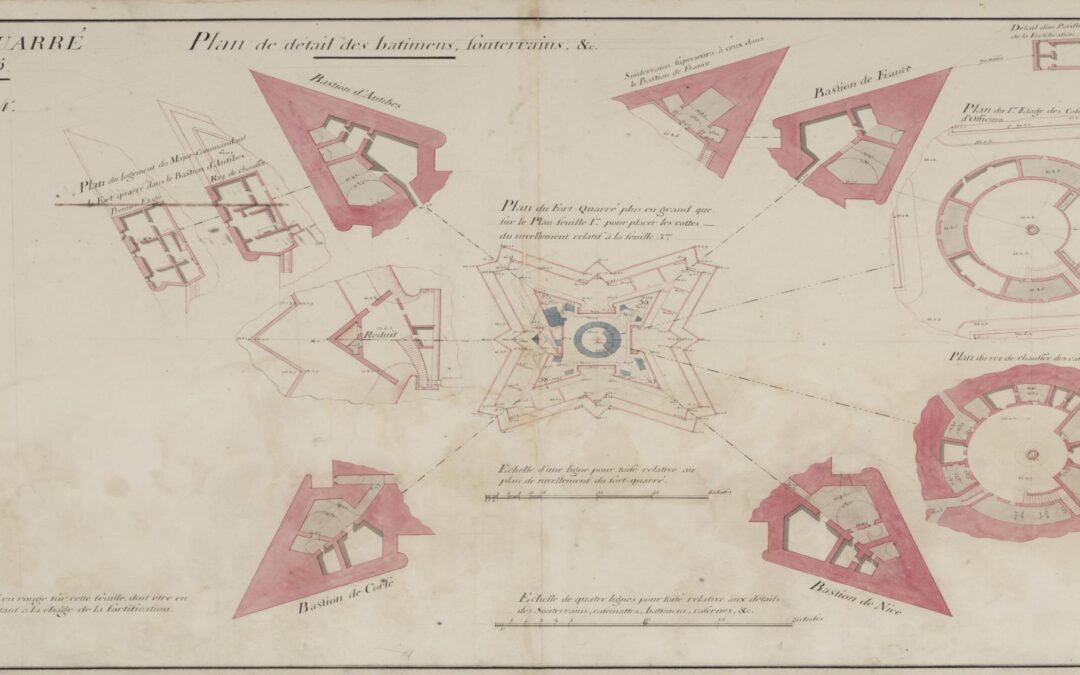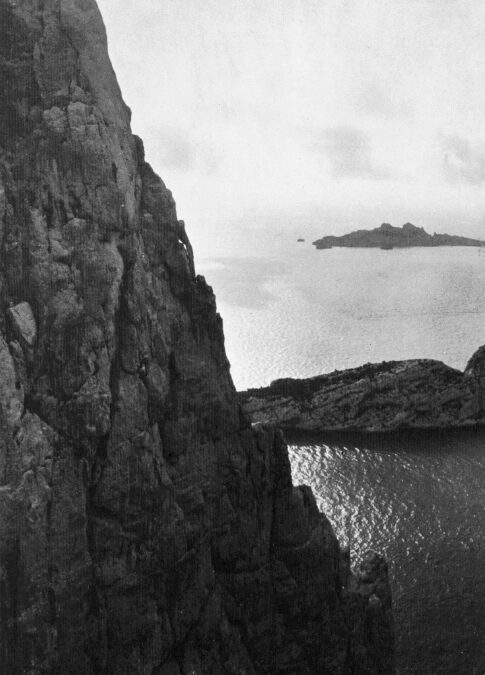Le stade de la Roseraie – Carpentras
Le stade de la Roseraie à Carpentras appartient indiscutablement à l’histoire mouvementée du Rugby à XIII. Même s’il n’est pas aussi prestigieux que le stade du Moulin à Lézignan, la Myre Mory à Villeneuve ou Gilbert Brutus à Perpignan, il jouit d’une grande notoriété parmi les treizistes.
Une longue gestation
Lorsqu’en 1938 le Racing Club de Carpentras (RCC) « passa à Treize » la ville ne disposait que du seul Stade municipal. C’était très insuffisant car il fallait y organiser des matchs de rugby, de football et surtout de motoball, un jeu nouveau, dévastateur pour les pelouses, mais déjà très populaire en Provence.
Pour remédier à cette pénurie, la ville, alors dirigée par Henri Dreyfus, acheta en décembre 1939 un terrain agricole de plus de quatre hectares aux portes de la ville dans le but d’y installer un nouveau terrain de sport. Le domaine comprenait aussi la grande villa de « la Roseraie » qui donnera son nom au stade. Entre 1940 et 1945, la délégation municipale nommée par Vichy n’y construisit rien et le terrain fut utilisé comme jardin potager.
Le gouvernement Pétain et son commissaire général à l’Éducation et aux Sports Jean Borotra ayant interdit le Rugby à XIII, le RCC fut contraint de jouer à nouveau à XV et continua à partager le Stade municipal avec le football. Les rationnements en essence avaient mis le motoball en sommeil.
Un stade « treiziste »
À la Libération le Comité national des spots toujours sous l’influence des mêmes pressions quinzistes ne voyait pas la vigoureuse reprise treiziste avec beaucoup de sympathie. Le rugby à XIII fut même contraint de changer de nom et la « Ligue française de rugby à XIII » devint « La fédération française de jeu à XIII » (arrêté du 11 Avril 1949). Elle est depuis redevenue Fédération française de rugby à XIII par jugement de la cour de cassation du 4 Juin 1993.
La ligne de front de la guerre des rugby n’était encore pas très nette, et en 1944 le RCC fut invité par la Fédération rugby à XV inquiète, à participer à la coupe de France et au championnat quinziste. Il fallait donc choisir formellement son camp. Une Assemblée générale extraordinaire opta à une large majorité pour la reprise treiziste comme ce fut le cas pour la plupart des clubs vauclusiens. Le SO Avignon qui n’avait pas fait partie de la première vague d’avant-guerre adhéra au mouvement dès sa reprise et fut admis dans la ligue professionnelle au côté du SU Cavaillon.
La municipalité carpentrassienne commença alors l’aménagement du futur « stade de la Roseraie ».
Des tribunes pas très légales
Les dirigeants du RCC prirent à leur compte la construction des tribunes selon un procédé tout à fait illégal puisqu’il contournait l’appel d’offre. La ville avait un devis de 1 900 000 francs. Une dizaine de dirigeants du club fonda une société ad hoc qui construisit les tribunes à ses frais. Aussitôt construites elles furent achetées par la ville au prix coutant. La dépenses n’ayant été que de 947 000 francs, la ville fit ainsi une économie d’un million de francs.
Un monument à la mémoire des joueurs du RCC XIII disparus pendant la guerre fut érigé sur le stade qui n’avait encore ni tribunes ni installations fixes. Le 27 avril 1947 lors d’un match opposant le RCC à l’équipe 2 du 13 Catalan, les deux capitaines, tous deux anciens internationaux treizistes, déposèrent une gerbe au pied de la statue.
Les tribunes furent inaugurées le 20 mars 1949 lors d’un match contre Toulouse dans le championnat « indépendant » (c’est ainsi qu’on appelait la seconde division, composée de clubs utilisant, en principe, des joueurs « amateurs », pour la distinguer de la première division « professionnelle »).
Au sol les tribunes occupaient un rectangle de 50m x 20m de grand axe Est/Ouest. La toiture était composée d’une charpente métallique recouverte de plaques de fibrociment culminant à 9 mètres, appuyée sur un mur postérieur de 6,7 mètres de haut en maçonnerie.
Les sept rangées de gradins étaient en bois. Sous les tribunes, on avait aménagé cinq vestiaires (joueurs et arbitres) avec des douches chauffées.
Dans les années 1950, lorsque le RCC put monter en première division, le nombre des spectateurs dépassa très souvent 1500 personnes et ces tribunes devinrent vite insuffisantes. On ajouta donc rapidement des « praticables » non couverts en tubes métalliques, de part et d’autre de la tribune abritée.
Des gradins en bois
La construction de gradins en bois peut surprendre à une époque où le béton était déjà largement utilisé, et surtout dans un pays où la préférence pour les constructions en pierre est attestée de longue date.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour expliquer ce choix et en premier lieu le confort. Les matchs de rugby se disputent le plus souvent l’hiver une saison où le mistral est fréquent et les stades mal orientés sont invivables (comme le parc des sports d’Avignon construit en 1975). En hiver à la Roseraie, le mur maçonné abritant les tribunes orientées au sud, le soleil bas frappe de face et vient agréablement réchauffer les spectateurs immobiles.
Les anciens stades comme St Ruf à Avignon, le stade Lombard à Cavaillon, et le stade de Villefranche qui était le stade précédent du RCC, tous construits vers 1922, avaient eux aussi des tribunes en bois, bien abritées, et étaient très agréables pour les spectateurs. Il faut dire que ces stades des années 1920 avaient été construits et financés par les clubs eux-mêmes, sur des terrains qui leur appartenait ou qu’ils louaient. N’ayant de comptes à rendre à personne ils les construisirent au mieux de leurs ressources et pour le confort de leurs spectateurs.
La Roseraie à Carpentras fut probablement le dernier stade vauclusien à être bâti selon les désirs du club résident. C’est ainsi par exemple qu’il est dépourvu de piste d’athlétisme et que les premiers rangs des spectateurs des tribunes ne sont qu’à 3 mètres de la pelouse. Cette proximité entre les spectateurs et le terrain fut d’ailleurs fréquemment source d’incidents, d’autant plus qu’il n’y eut jamais de grillage pour isoler les joueurs… et les arbitres. Une particularité qu’il partage avec d’autres stades « historique » comme le stade du Moulin à Lézignan par exemple.
Une utilisation très originale des gradins en bois de la Roseraie mérite d’être signalée. Les constructeurs ne l’avaient certainement pas prévue, mais elle avait fini par faire partie du « paysage sonore » du stade. Lorsque le RCC se rapprochait de la ligne adverse tous les spectateurs tapaient des pieds en se servant des gradins comme d’un tambour de guerre. C’était bien commode pour les juniors qui, leur match achevé, prenaient leur douche en dessous et étaient ainsi tenus au courant de l’évolution de la partie, et même du score car le vacarme redoublait lorsque Carpentras avait marqué un essai. Mais c’était certainement aussi très dangereux et en 1996 la mairie décida qu’à la longue cette utilisation ludique et tonitruante pouvait avoir quelques effets regrettables et qu’il fallait consolider les tribunes.
La rénovation de 1996
L’architecte parvint à conserver l’allure générale et les dimensions de l’ensemble, mais la nouvelle construction ne permettait pas de maintenir les vestiaires sous les tribunes. On en construisit donc de nouveaux en choisissant une architecture « néo-provençale » pour le moins surprenante.
La construction en 2013 d’un préau entre l’ancienne entrée et les tribunes permit au club d’organiser différentes manifestations (goûter pour les jeunes, petites cérémonies de récompenses, réceptions des autorités, etc.) et d’abriter les clients de la buvette. On y a posé en 2016 une plaque rappelant le monument aux morts qui avait été détruit plusieurs années plus tôt, alors qu’on tentait de le déplacer.
Les spectateurs
À partir de 1951 lorsque le RCC fut admis en première division, l’affluence était régulièrement de 1500 à 2000 spectateurs. Elle atteignait même les 3000 lors des derbys avec Cavaillon et surtout Avignon. Mais ce n’est pas lors d’un de ces derbys que le record fut établi. En 1955, la Roseraie fut désignée pour la finale de la coupe de France qui opposa le SOA à Marseille XIII. Des levées de terre avaient été ajoutées tout autour du stade pour accueillir des spectateurs debout et l’affluence dépassa 9 000 spectateurs. Il est certain qu’au vu des exigences actuelles en matière de sécurité aucun organisateur ne prendra plus le risque de rassembler une telle foule à la Roseraie et qu’en conséquence ce record ne sera jamais battu.
Le règne du RCC sur le stade de la Roseraie connut une éclipse notable lorsqu’en 1966 le Football Club conduit par un président ambitieux (qui était aussi premier adjoint au maire) recruta l’international français, héros de la Coupe du monde 1958, Roger Piantoni, alors âgé de 35 ans, comme capitaine-entraineur. Le RCC dut alors partager pendant deux saisons son terrain « historique » avec les footballeurs.
En Novembre 1966, Roger Piantoni organisa son jubilé à la Roseraie. Pour cet événement il avait rassemblé beaucoup de personnalités du football (anciens du championnat du monde de 1962 comme Just Fontaine et Raymond Kopa), du sport et du spectacle (Michel Jazy, Jean-Paul Belmondo) et la foule dépassa 5 000 spectateurs.
Depuis sa première montée en première division le RCC a connu une carrière fluctuante tantôt en première division tantôt en deuxième, mais depuis plus de trente ans le stade de la Roseraie n’a pas connu d’affluence supérieure à 1000 personnes.
Actuellement (2019), le RCC qui tient un rôle très convenable en Elite 2 peut compter sur une affluence moyenne d’environ 300 spectateurs.
Bibliographie
Rylance Mike, Le rugby interdit : l’histoire occultée du rugby à XIII en France, Limoux, Cano et Franck, 2006.